
AVION DE PATROUILLE MARITIME QUADRIMOTEUR
- Historique
- Genèse d'un bombardier
- Cinquante-quatre Western Union Lancaster pour l'Aéronautique navale (1951 - 1964)
- Escadrille 4.S ( 1957-1960)
- Escadrille 5.S
- Escadrille 9.S (1957-1964)
- Escadrille 10.S
- Escadrille 52.S (1961-1962)
- Escadrille 55.S (1952-1961)
- Escadrille 56.S (1958-1961)
- Flottilles 2.F/ 23.F (1952-1956)
- Flottilles 10.F/ 24.F (1952-1958)
- Flottilles 11.F/ 25.F (1952-1958)
- Section Liaison du Maroc (SLM)
- Cinq French Civil Lancaster pour les missions SAMAR
- En Savoir Plus
Le bombardier lourd, démesuré, d'Avro fut littéralement le phoenix qui naquît des cendres du désastreux programme du Manchester de 1940-41. Ce dernier était motorisé par 2 Rolls-Royce Vulture et présentait les mêmes caractéristiques que le Lancaster, mais était dès le début handicapé par de graves problèmes de résistances des moteurs. Néanmoins Avro comprit le potentiel de la cellule et demanda à Rolles Royce de lui fournir des moteurs Merlin à la fiabilité prouvée. Le Manchester était également sous-motorisé, et l'ingénieur en chef d'Avro s'assura que le successeur du Manchester ne le serait pas en installant 4 Merlin X sous les ailes. Le prototype (un Manchester modifié) vola le 9 janvier 1941 et son potentiel fut découvert au cours des essais poussés. Une commande pour 1.070 bombardiers fut signée avec Avro mi-1941 et les premiers appareils de série sortirent en octobre. Le 44 Squadron vit le baptême de feu en mars 1942, et 58 autres unités du Bomber Command utilisèrent l'avion, effectuant 156.000 sorties et larguant 608.612 tonnes de bombes explosives et 51 millions de bombes incendiaires. Quelques 7.377 cellules furent construites dans les 6 usines dédiées au Lancaster, totalisant 5 versions différentes de l'avion.
Cinquante-quatre
Western Union Lancaster pour l'Aéronautique navale (1951 - 1964)
Le traité
commun de défense de l'Union de l'Europe occidentale (UEO
- WEU) permet à l'Aéronautique navale d'être
dotée de 54 Lancaster, 32 en version Mk. I et 22 en version
Mk. VII. Les avions proviennent du dépôt 38 MU de
la RAF et sont livrés chez Avro sur le terrain de Woodford,
près de Manchester, à partir de janvier 1952. Le
CC Aragnol, officier de marque, assure la réception des
avions qui sont ensuite convoyés à la DCAN Cuers
où ils reçoivent des modifications pour leur aptitude
ASM (radar APS-15, chaîne SAR, etc.). Le vol de réception
du premier appareil, le WU 1, a eu lieu le 7 décembre 1951.
Escadrille
4.S ( 1957-1960)
 Cette unité d'entraînement basée à
Karouba (Tunisie) utilise plusieurs types d’appareils dont
quelques Lancaster (5 en 1957, 5 en 1958, 6 en 1959 et 1 en 1960)
qui furent utilisés entre février 1957 et février
1960 à raison d’un total de 4.500 heures de vol. En février 1957, cinq
Lancaster sont mis en service à la 4.S et soutiennent les
P2V-6 Neptune des flottilles 21.F et 22.F pour les missions de
Surveillance Maritime (Surmar) entre Gibraltar et Malte dans le
contexte de la Guerre d'Algérie.
Cette unité d'entraînement basée à
Karouba (Tunisie) utilise plusieurs types d’appareils dont
quelques Lancaster (5 en 1957, 5 en 1958, 6 en 1959 et 1 en 1960)
qui furent utilisés entre février 1957 et février
1960 à raison d’un total de 4.500 heures de vol. En février 1957, cinq
Lancaster sont mis en service à la 4.S et soutiennent les
P2V-6 Neptune des flottilles 21.F et 22.F pour les missions de
Surveillance Maritime (Surmar) entre Gibraltar et Malte dans le
contexte de la Guerre d'Algérie.
 Le 15 juin 1957,
un Lancaster prend des photos du Juan Illuecca accosté
dans le port de Ceuta ce qui entraîne une protestation officielle
de l'Espagne. L'activité annuelle de Surmar de la 4.S est
de 1.537 heures. A l'été
1958 et pendant les travaux effectués à Lartigue,
la 4.S et ses cinq Lancaster opère en partie depuis Alger
et La Sénia. A la demande du GATAC 2, les Lancaster de
l'escadrille effectuent des missions d'éclairage et de
bombardement de nuit sur la frontière algéro-marocaine. Leur participation sur la
frontière est de 1.102 h dans l'année avec quatre
avions et quatre équipages.
Le 15 juin 1957,
un Lancaster prend des photos du Juan Illuecca accosté
dans le port de Ceuta ce qui entraîne une protestation officielle
de l'Espagne. L'activité annuelle de Surmar de la 4.S est
de 1.537 heures. A l'été
1958 et pendant les travaux effectués à Lartigue,
la 4.S et ses cinq Lancaster opère en partie depuis Alger
et La Sénia. A la demande du GATAC 2, les Lancaster de
l'escadrille effectuent des missions d'éclairage et de
bombardement de nuit sur la frontière algéro-marocaine. Leur participation sur la
frontière est de 1.102 h dans l'année avec quatre
avions et quatre équipages.
La 4.S, à
son apogée, effectue dans l'année 2.215 heures en
Surmar, soit 3,5 fois plus que les patrouilles faites par les
21.F et 22.F.  L'emploi intensif des Lancaster les conduit rapidement
à l'échéance de potentiel. En 1959, l'escadrille
dispose toujours de quatre Lancaster pour effectuer pas moins
de 975 heures en Surmar, 850 heures de surveillance sur la frontière
algéro-marocaine et 350 heures au profit de la DBFM (Demi
Brigade de Fusiliers Marins). La 4.S perd son aptitude opérationnelle
à la Surmar avec le retrait de trois Lancaster au SEA de
Lartigue le 23 janvier 1960, et du quatrième le 15 février.
L'emploi intensif des Lancaster les conduit rapidement
à l'échéance de potentiel. En 1959, l'escadrille
dispose toujours de quatre Lancaster pour effectuer pas moins
de 975 heures en Surmar, 850 heures de surveillance sur la frontière
algéro-marocaine et 350 heures au profit de la DBFM (Demi
Brigade de Fusiliers Marins). La 4.S perd son aptitude opérationnelle
à la Surmar avec le retrait de trois Lancaster au SEA de
Lartigue le 23 janvier 1960, et du quatrième le 15 février.
Ils ont effectué dans le mois 192
heures de Surmar. L’unité déménage à
Lartigue pour y rester jusqu’à sa dissolution en 1962.
Escadrille
5.S
Basée à Lartigue (Algérie), la 5.S est également
une unité d’entraînement qui utilise plusieurs
types d’avions, principalement pour des cours de rafraîchissement
pour la réserve volontaire. Quelques Lancaster sont alloués
pour des missions de reconnaissance pendant la guerre d’Algérie.
Elle est dissoute lors du retrait des Forces Françaises
d’Algérie.
Escadrille
9.S (1957-1964)
 Elle est mise en place à Lann-Bihoué à l’été 1957 avec trois Lancaster spécialement
équipés pour les missions outre-mer et peints en
blanc. Les WU-16, WU-27 et WU-41 arrivent dans le ciel de Tontouta
(Nouvelle-Calédonie) pour effectuer des missions de surveillance
maritime. Ils sont remplacés fin 1962 par les WU-13, WU-15
et WU-21.
Elle est mise en place à Lann-Bihoué à l’été 1957 avec trois Lancaster spécialement
équipés pour les missions outre-mer et peints en
blanc. Les WU-16, WU-27 et WU-41 arrivent dans le ciel de Tontouta
(Nouvelle-Calédonie) pour effectuer des missions de surveillance
maritime. Ils sont remplacés fin 1962 par les WU-13, WU-15
et WU-21.  Il s’agit de la dernière unité ayant
utilisé le Lancaster.
Il s’agit de la dernière unité ayant
utilisé le Lancaster.
Le 26 janvier
1963, à l'issue d'un vol de liaison sur Wallis, le WU21
efface le train d'atterrissage droit et s'immobilise sur la piste
en herbe. Remis sur son train à l'aide de ballons, il est
remorqué jusqu'au bord du terrain. Il y restera 21 ans
par suite de sa condamnation sur place, deux moteurs ayant été
touchés dans l'accident. Les Wallisiens l'adoptèrent
pour le dépiauter petit à petit au fil des années
et, en 1983, il n'était plus qu'une épave. Les Lancaster
sont remplacés par deux C-54
Skymaster.
Escadrille
10.S
Quelques Lancaster furent utilisés par cette escadrille
basée à Fréjus-Saint-Raphaël pour des missions de servitudes et quelques expérimentations
(missile Malafon et fusée postale CENT notamment) au profit
de la Commission d’Etudes
Pratiques de l’Aéronautique (CEPA).
Escadrille
52.S (1961-1962)
 Créée à Khouribga (Maroc), cette escadrille
assure le perfectionnement au pilotage des élèves
fraîchement débarqués de la formation ab initio.
Créée à Khouribga (Maroc), cette escadrille
assure le perfectionnement au pilotage des élèves
fraîchement débarqués de la formation ab initio.
Après une courte période de mise en sommeil, elle
renaît de ses cendres en janvier 1961 à Port Lyautey
(Tunisie) où elle reçoit une douzaine de Lancaster
et devient unité de conversion sur appareils lourds.
Un
total de 1.800 heures de vol est effectué sur Lancaster.
La 52.S est dissoute
le 15 janvier 1962.
Escadrille
55.S (1952-1961)
 La 55.S a pour but de former les pilotes sur multimoteurs à partir
de la base d’Agadir au Maroc. Elle est la seconde unité
de l’Aéronautique navale à mettre en service
le Lancaster. Les premières livraisons ont eu lieu à
partir d’avril 1952. La 55.S est la seule unité de conversion sur le type. Par conséquence,
25.800 heures de vol ont été effectuées sur
le type. Elle est également impliquée dans les missions
de surveillance pendant la Guerre d'Algérie.
La 55.S a pour but de former les pilotes sur multimoteurs à partir
de la base d’Agadir au Maroc. Elle est la seconde unité
de l’Aéronautique navale à mettre en service
le Lancaster. Les premières livraisons ont eu lieu à
partir d’avril 1952. La 55.S est la seule unité de conversion sur le type. Par conséquence,
25.800 heures de vol ont été effectuées sur
le type. Elle est également impliquée dans les missions
de surveillance pendant la Guerre d'Algérie.
 Le 30 août
1957, le Lancaster 55.S-Delta piloté par le PM Thomé,
découvre un caboteur mouillé à courte distance
d'une plage près de Tarfaya ; le bâtiment est relié
à la côte par deux filins le long desquels glissent
des embarcations chargées de caisses et de ballots suspects.
A la troisième passe à basse altitude, des chameaux
s'égayent dans les dunes et des hommes sur la plage tirent
quelques coups de fusils, sans résultat. Elle est également
responsable des missions Search and Rescue au large du Maroc et
opère pour cela quelques Lancaster du S.G.A.C.C. jusqu’au
retrait du type en 1960.
Le 30 août
1957, le Lancaster 55.S-Delta piloté par le PM Thomé,
découvre un caboteur mouillé à courte distance
d'une plage près de Tarfaya ; le bâtiment est relié
à la côte par deux filins le long desquels glissent
des embarcations chargées de caisses et de ballots suspects.
A la troisième passe à basse altitude, des chameaux
s'égayent dans les dunes et des hommes sur la plage tirent
quelques coups de fusils, sans résultat. Elle est également
responsable des missions Search and Rescue au large du Maroc et
opère pour cela quelques Lancaster du S.G.A.C.C. jusqu’au
retrait du type en 1960.
En janvier 1961,
l’escadrille déménage vers la base corse d’Aspretto et elle retire ses Lancaster au fur et à mesure.
Escadrille
56.S (1958-1961)
L’escadrille 56.S/ école du personnel volant et radariste
basée à Agadir (Maroc) utilisa quelques Lancaster
qui volèrent peu puisque seulement 1.000 heures de vol
furent effectuées sur le type. L’unité déménage
vers Lann-Bihoué en octobre 1960. Les Lancaster sont progressivement remplacés
par des C-47D Dakota au même moment.
Flottilles
2.F/ 23.F (1952-1956)
La 2.F de la BAN Port-Lyautey
(Maroc) est la première unité à recevoir
le Lancaster. Ils viennent remplacer à partir de janvier
1952 les vieux Vickers Wellington. Un échelon précurseur
de la 2.F comprenant
30 personnes est envoyé le 29 novembre 1951 au 210 squadron
du centre de formation de la RAF/ Coastal Command de Saint-Eval
(Cornouailles, Grande-Bretagne) pour une formation théorique
et pratique sur Lancaster. Le 21 décembre le Lancaster
WU-02 (futur 2.F-1) est livré à Saint-Eval et subit
ses premiers vols d’essais avec le CC Mellet et le Flight
Lieutenant Mays aux commandes. Le 22 janvier 1952, c’est
au tour du WU-03 d’être convoyé de Manchester
à Saint-Eval. Le même jour, à 8h15 le 2.F-1
décolle en direction du Maroc. Il se pose à Port-Lyautey
à l’issue d’un vol qui a duré 5h50.
Le 23 janvier, le 2.F-2 quitte à son tour Saint-Eval pour
Port-Lyautey.  Le 3 mars, le 2.F-3 WU-06 arrive à Port-Lyautey,
puis le 11 et le 14 mars, ce sont les WU-04, -05, -06 qui sont
versés à la flottille. Jusqu’au mois d’août
1952 les convoyages de Lancaster se succèdent pour porter
l’effectif de la 2.F à dix appareils. Le 9 avril,
le WU-09 en convoyage entre Villacoublay et Port-Lyautey voit
ses moteurs s’arrêter brusquement et l’appareil
atterrit dans un silence complet sur la base marocaine. Deux appareils
sont envoyés (2.F-1 et 2.F-6) à Hyères le
28 juin pour une formation au sein du Groupe Anti-Sous-Marin (G.A.S.M.).
Le 30 juillet, les appareils quittent la métropole.
Le 3 mars, le 2.F-3 WU-06 arrive à Port-Lyautey,
puis le 11 et le 14 mars, ce sont les WU-04, -05, -06 qui sont
versés à la flottille. Jusqu’au mois d’août
1952 les convoyages de Lancaster se succèdent pour porter
l’effectif de la 2.F à dix appareils. Le 9 avril,
le WU-09 en convoyage entre Villacoublay et Port-Lyautey voit
ses moteurs s’arrêter brusquement et l’appareil
atterrit dans un silence complet sur la base marocaine. Deux appareils
sont envoyés (2.F-1 et 2.F-6) à Hyères le
28 juin pour une formation au sein du Groupe Anti-Sous-Marin (G.A.S.M.).
Le 30 juillet, les appareils quittent la métropole.
Sept Lancaster
participent à l’exercice Mainbrace mi-septembre au
large de l’Irlande du Nord.  Le 25 septembre, une fois l’exercice
achevé, les sept appareils quittent Bally-Kelly pour un
vol direct sur le Maroc. Le 28 octobre, les 2.F-2, 2.F-3, 2.F-5
et 2.F-6 décollent de Port-Lyautey pour rallier Hyères afin de participer à l’exercice interallié
Long Step qui s’achève le 13 novembre. Le 20 janvier
1953, le 2.F-2 décolle de nuit pour l’entraînement
de deux nouveaux pilotes et s’écrase à l’atterrissage.
Tout l’équipage est indemne.
Le 25 septembre, une fois l’exercice
achevé, les sept appareils quittent Bally-Kelly pour un
vol direct sur le Maroc. Le 28 octobre, les 2.F-2, 2.F-3, 2.F-5
et 2.F-6 décollent de Port-Lyautey pour rallier Hyères afin de participer à l’exercice interallié
Long Step qui s’achève le 13 novembre. Le 20 janvier
1953, le 2.F-2 décolle de nuit pour l’entraînement
de deux nouveaux pilotes et s’écrase à l’atterrissage.
Tout l’équipage est indemne.
Elle conserve un parc de dix appareils
jusqu'au 20 juin 1953 où elle est renommée 23.F.
Elle utilise les Lancaster avec les R.A.F. serials suivants
:
-Version Mk. I : RA795, SW297, TW655.
-Version Mk. VII : NX620, NX666, NX669, NX703, RT682, RT697,
RT698, RT699.
Les appareils effectuent des missions de lutte ASM et de surveillance
maritime en Méditerranée. Les
Lancaster sont remplacés début 1956 par des P2V-6
Neptune.
Flottilles
10.F/ 24.F (1952-1958)
Début mars 1952, un détachement de la 10.F arrive
à Port-Lyautey au sein de la 2.F pour suivre un stage de
formation sur Lancaster et commencer à voler quelques jours
plus tard. 
 En effet du 14 au 28, l’instruction en vol démarre
avec vingt heures de vol de jour et une heure trente de nuit.
Le stage se termine le 5 avril. Créée le 15 juin
1952 sur la base bretonne de Lann-Bihoué, la 10.F reçoit
ses Lancaster le même mois. Elle est renommée 24.F,
le 20 juin 1953.
En effet du 14 au 28, l’instruction en vol démarre
avec vingt heures de vol de jour et une heure trente de nuit.
Le stage se termine le 5 avril. Créée le 15 juin
1952 sur la base bretonne de Lann-Bihoué, la 10.F reçoit
ses Lancaster le même mois. Elle est renommée 24.F,
le 20 juin 1953.
Les appareils
effectuent des missions de lutte ASM et de surveillance maritime
en Atlantique. En avril 1954, la flottille est envoyée
en Indochine (Tan-Son-Nhut) où elle reçoit des Convair
P4Y-2 Privateer. Elle revient à Lann-Bihoué en octobre
1954 pour y retrouver ses Lancaster B1 qui sont retirés
du service en mars 1958 au profit de P2V-7
Neptune.
Flottilles
11.F/ 25.F (1952-1958)

 La 11.F voit le jour le 1er août 1952 sur la base algérienne
de Lartigue où elle y reçoit quelques Lancaster
pour effectuer des missions de patrouille maritime sur la côte
méditerranéenne. Elle déménage vers
la BAN
Lann-Bihoué en mars 1953 où elle se scinde en
deux unités :
La 11.F voit le jour le 1er août 1952 sur la base algérienne
de Lartigue où elle y reçoit quelques Lancaster
pour effectuer des missions de patrouille maritime sur la côte
méditerranéenne. Elle déménage vers
la BAN
Lann-Bihoué en mars 1953 où elle se scinde en
deux unités :
-La 11.F, une
unité embryonnaire sans avions envoyée aux Etats-Unis
pour prendre livraison des P2V-6
Neptune. Ce détachement donnera naissance à
son retour en France, aux flottilles 21.F et 22.F.
-La 25.F, flottille
qui opèrent sur les Lancaster de la 11.F.
Les Lancaster sont remplacés en juillet 1958 par des P2V-7
Neptune.
Section Liaison du Maroc (SLM)
Cette section opère deux Lancaster au Maroc pour des missions
de liaison et de servitudes.
Cinq French Civil Lancaster
pour les missions SAMAR
 Avant
la fin de la seconde guerre mondiale, une première conférence
internationale (Chicago, 1944) jette les bases de la future aviation
civile mondiale du temps de paix, et mis en place ce qui est encore
aujourd’hui l’O.A.C.I. (Organisation de l’Aviation
Civile Internationale). Au risque de simplifier abusivement, on
peut dire que l’O.A.C.I. n’a pas seulement réglementé
des problèmes juridiques complexes, mais a également
favorisé la mise en place de moyens techniques propres
à améliorer la sécurité de la navigation
aérienne. Il y avait, par exemple, le réseau de
frégates météo sur l’Atlantique nord
ou, plus durable encore, la constitution d’un service de
sauvetage aéro-maritime pour les longs survols au dessus
des océans. La convention passée dans ce sens à
Montréal après la guerre prévoyait l’attribution
de cette responsabilité à des organismes civils.
Donc, pour la France, au Secrétariat Général
de l’Aviation Civile et Commerciale (S.G.A.C.C.) qui, créé
fin 1945, relevait du Ministère des Travaux Publics et
des Transports.
Avant
la fin de la seconde guerre mondiale, une première conférence
internationale (Chicago, 1944) jette les bases de la future aviation
civile mondiale du temps de paix, et mis en place ce qui est encore
aujourd’hui l’O.A.C.I. (Organisation de l’Aviation
Civile Internationale). Au risque de simplifier abusivement, on
peut dire que l’O.A.C.I. n’a pas seulement réglementé
des problèmes juridiques complexes, mais a également
favorisé la mise en place de moyens techniques propres
à améliorer la sécurité de la navigation
aérienne. Il y avait, par exemple, le réseau de
frégates météo sur l’Atlantique nord
ou, plus durable encore, la constitution d’un service de
sauvetage aéro-maritime pour les longs survols au dessus
des océans. La convention passée dans ce sens à
Montréal après la guerre prévoyait l’attribution
de cette responsabilité à des organismes civils.
Donc, pour la France, au Secrétariat Général
de l’Aviation Civile et Commerciale (S.G.A.C.C.) qui, créé
fin 1945, relevait du Ministère des Travaux Publics et
des Transports.
 Dans la pratique,
il fut décidé que ces tâches seraient dévolues,
si c’était nécessaire, ou plus efficace, ou
plus rentable, à des équipages militaires sur des
avions plus ou moins adaptés à cette mission essentiellement
pacifique de recherche et de sauvetage des naufragés en
mer. Des conventions furent donc passées avec les forces
armées, avec un partage géographique de zones de
responsabilité entre Armée de l’air et l’Aéronautique
navale. Ce qui explique assez bien la situation parfois complexe
des appareils SAR français : SE.161 Languedoc SAR civils
ou Constellation du S.G.A.C.C. pilotés par des gens de
l’Armée de l’air, Lancaster FCL mis en œuvre
par des marins.
Dans la pratique,
il fut décidé que ces tâches seraient dévolues,
si c’était nécessaire, ou plus efficace, ou
plus rentable, à des équipages militaires sur des
avions plus ou moins adaptés à cette mission essentiellement
pacifique de recherche et de sauvetage des naufragés en
mer. Des conventions furent donc passées avec les forces
armées, avec un partage géographique de zones de
responsabilité entre Armée de l’air et l’Aéronautique
navale. Ce qui explique assez bien la situation parfois complexe
des appareils SAR français : SE.161 Languedoc SAR civils
ou Constellation du S.G.A.C.C. pilotés par des gens de
l’Armée de l’air, Lancaster FCL mis en œuvre
par des marins.
Pour ce qui
concerne l’Aéronautique navale, outre les traditionnelles
missions purement opérationnelles ou celles de formation
et d’entraînement du personnel volant, étaient
inscrites dans son plan de mission des activités de service
public variées et la participation au sauvetage de vies
humaines : opérations de recherches de navires ou aéronefs
disparus ou en difficulté, avec une distinction SAMAR (Sauvetage
Aéromaritime) et SATER (Sauvetage Terrestre). Dans la mesure
où l’Aéronautique navale disposait d’une
flotte opérationnelle importante de quadrimoteurs Lancaster,
la tentation était grande pour la S.G.A.C.C. d’acquérir
d’autres Lancaster pour mise à la disposition de
la Marine dans le cadre des accords SAMAR.
 Il est d’ailleurs
intéressant de constater que, dès 1952, le Ministère
de la Marine d’alors avait commandé six « airborne
lifeboats », embarcations spécialisées et pouvant
être larguées depuis un avion en vol. La commande des Lancaster
« SGACC », comme on les appelait parfois dans la Royale
suivit donc celle des avions d’armes « Western Union »,
sur des fonds civils donc, puisque prévus pour le S.G.A.C.C.
Mais les avions furent mis en œuvre par l’Aéronautique
navale.
Il est d’ailleurs
intéressant de constater que, dès 1952, le Ministère
de la Marine d’alors avait commandé six « airborne
lifeboats », embarcations spécialisées et pouvant
être larguées depuis un avion en vol. La commande des Lancaster
« SGACC », comme on les appelait parfois dans la Royale
suivit donc celle des avions d’armes « Western Union »,
sur des fonds civils donc, puisque prévus pour le S.G.A.C.C.
Mais les avions furent mis en œuvre par l’Aéronautique
navale.
Selon le même
processus utilisé pour les « Western Union »,
les cinq Lancaster déstockés et reconditionnés
au standard MR.3 de la Royal Air Force (avec gouvernails différents
et train de Lincoln) furent pris en charge à Langar. Dès
le départ, les marins furent responsables des appareils,
la réception et le convoyage vers Orly étant assurés
par l’E.R.C. (Escadrille de Réception et de Convoyage).
Deux appareils furent conduits en France par l’officier
des équipages Boubée, un autre par Combier, mais
il n’a pas été possible de retrouver les responsables
de la prise en charge des deux autres. Ce transfert laissa en
tout cas un assez mauvais souvenir, car les crédits limités
n’octroyaient que 800 gallons de carburant pour le vol de
livraison, et Combier se posa à Orly bien près de
la panne sèche pure et simple !
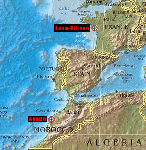 Le choix du
Lancaster fut probablement un bon choix. Comme évoqué
plus haut, dans le cadre des accords internationaux, chaque état
possédait sur son territoire métropolitain ou colonial
des sections aéronautiques de recherche spécialisée,
soit autonomes, soit intégrées à une formation
militaire. L’Aéronautique navale mit donc en place
ses Lancaster FCL dans des sections SAMAR directement intégrées
dans des formations d’avions ASM lourds.
Le choix du
Lancaster fut probablement un bon choix. Comme évoqué
plus haut, dans le cadre des accords internationaux, chaque état
possédait sur son territoire métropolitain ou colonial
des sections aéronautiques de recherche spécialisée,
soit autonomes, soit intégrées à une formation
militaire. L’Aéronautique navale mit donc en place
ses Lancaster FCL dans des sections SAMAR directement intégrées
dans des formations d’avions ASM lourds.
Les Lancaster FCL furent donc attribués à trois
formations :
-deux flottilles opérationnelles : la 24.F et la 25.F,
toutes deux basées à Lann-Bihoué.
-une formation école, l’escadrille 55.S, installée
à Agadir au Maroc.
Bien entendu, ces avions restaient officiellement à la
section SAMAR, et, en principe, un appareil en état d’alerte
perpétuelle à 30 minutes de décollage dans
chaque base.
L’Aéronautique
navale avait d’autres responsabilités SAMAR : l’une
attribuée aux JFR-5 Goose de la 8.S à Cat-Laï
en Indochine, l’autre aux hydravions Sunderland de l’Ecole
d’Ecoute des Bouées Sonores (E.E.B.S./ escadrille
12.S) à Saint-Mandrier, près de Toulon.
Les visites de 3ème dégré (V3) prévues
au bout de 600 heures furent effectuées à Lann-Bihoué courant 1957, au moins pour trois des appareils, et les avions
furent mis en extinction, toujours sous le couvert du Service
Central de l’Aéronautique navale, à l’automne
1960.
Les missions SAR sont aujourd’hui assurées par les
aéronefs suivants dans l’Aéronautique navale
:
-Cinq hélicoptères SA.365N Dauphin de la flottille
35.F basée à Cherbourg, Le Touquet, Hyères,
La Rochelle et Lanvéoc-Poulmic
-Deux hélicoptères SA.321G Super-Frelon de la flottille
32.F basée à Lanvéoc-Poulmic et Hyères.
-Falcon 50 SURMAR (24.F, Lann-Bihoué), Atlantique 2 (21.F,
Nîmes-Garons – 23.F, Lann-Bihoué), Falcon 200
Gardian (25.F, Tontouta/ Tahiti-Faa’a).
sources - remerciements :
Jean-Pierre DUBOIS.
"Quand je trouve je pique
La flottille 2F en Afrique (1940-1953)" du Philippe Bonnet ; ARDHAN - 2002
"L’Aéronautique
navale en Algérie (1954-1962)" de l'Officier en chef des Equipages
(h) Henri Robin ; ARDHAN - 2002.
©French Fleet Air
Arm. www.ffaa.net. All rights reserved.